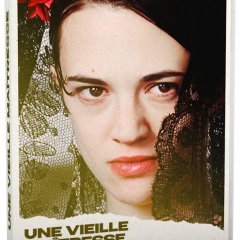Lea Seydoux : passages TV et dernières sorties DVD/Blu-ray
Roubaix, une lumière
Télévision : 23 octobre à 13:35-15:50 sur Arte
film
Lucette, une vieille dame de 83 ans, est tuée chez elle la nuit de Noël, dans un quartier morne de Roubaix. Les meurtriers sont repartis avec un butin dérisoire, une télé, quelques produits d'entretien et une boîte de nourriture pour chiens. Marie et Claude, deux voisines de la défunte, toxicomanes, alcooliques et amoureuses sont interrogées par Daoud, un flic au flair implacable, un homme doux et très humain, et Louis, une jeune recrue idéaliste. Pour les amener à reconnaître leur faute, Daoud va les interroger, sans jugement et en tentant de comprendre d'où vient toute cette souffrance et cette colère...
Année : 2019
De : Arnaud Desplechin
Avec : Antoine Reinartz, Betty Cartoux, Chloé Simoneau, Christophe Filbien, Christophe Hennart, Jérémy Brunet, Léa Seydoux, Philippe Duquesne, Roschdy Zem, Sara Forestier, Stéphane Duquenoy, Sébastien Delbaere
Une vieille maîtresse - Blu-ray
DVD/Blu-ray : 1er octobre
Editeur : Le Chat qui Fume
Année : 2006
De : Catherine Breillat
Avec : Asia Argento, Fu&039 ad Ait Aattou, Roxane Mesquida, Claude Sarraute, Yolande Moreau, Michael Lonsdale, Anne Parillaud, Amira Casar, Caroline Ducey, Lio, Isabelle Renauld, Léa Seydoux